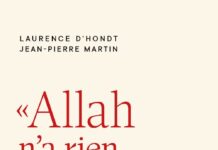Vous l’avez remarqué comme nous ? Curieusement, droite et gauche se rejoignent pour ériger le respect en vertu cardinale. A droite, Valérie Glatigny inaugure son mandat de ministre de l’Education par une vaste enquête auprès des enseignants et la publication d’un « baromètre du respect ». Dans la rue, les travailleurs de l’éducation rappellent leur ministre au respect qu’elle leur doit. Dans les classes comme en salle des profs, s’il est bien un terme débattu quotidiennement, c’est celui-là. Force est de constater qu’il recouvre des aspirations bien différentes selon les protagonistes. Et si nous sortions de la confusion et dessinions les contours du respect que nous, militants de l’Aped, voulons voir s’imposer dans le système scolaire ?
Un article initialement publié dans L’École démocratique, n°102, juin 2025 (pp. 13-17).
Pour illustrer notre propos, permettez-nous de faire appel à quelques souvenirs.
« Ben non, m’sieur, on ne vous a pas manqué de respect ! »
Niveau 1, en première ligne. Mes élèves de 5ème professionnelle étaient réellement interloqués. Et je dois dire qu’effectivement, depuis qu’avait débuté le cours, aucun d’entre eux ne m’avait adressé de geste ou de propos offensant. Personne ne m’avait « traité », comme ils disaient… En fait, je m’étais donné du mal à préparer cette séquence de cours que je me réjouissais de leur donner et je supportais mal leur manque d’intérêt, la résistance de leur inertie, leurs bavardages diffus, leur distraction. Rien de ce que j’essayais ne fonctionnait vraiment. C’est quand je leur avais fait remarquer qu’ils me manquaient de respect que j’avais soudain capté leur attention et suscité un tollé : qu’est-ce que j’allais chercher là ? Ils n’avaient pas été grossiers, personne ne m’avait manqué de respect !
S’ensuivit un échange où il fut question des diverses significations que peut recouvrir le terme de « respect ». Eux entendaient convenances, politesse, absence d’agression verbale, d’insulte… Moi, je leur demandais de porter une attention au travail que j’avais mitonné et que j’entendais mener avec eux. Il est fort probable que je leur aie redit une fois encore combien m’importait de profiter au maximum du peu d’heures de français dont nous disposions pour aller le plus loin possible dans la maîtrise de la langue et de la culture à laquelle elle permet d’accéder. Que, pour moi, tous les jeunes, y compris ceux qui fréquentent la filière professionnelle, doivent s’armer intellectuellement. Pour être des citoyens à part entière. Qu’exiger d’eux, par exemple, l’effort de lire des textes littéraires difficiles au premier abord, c’était justement ça, les respecter. A rebours des quelques collègues qui affirmaient qu’« avec les P, tant que tu les occupes et qu’ils se tiennent tranquilles, tu as gagné. »
« Le respect ne peut pas tricher, puisqu’il prend en compte la dignité humaine dans sa globalité : la personne et/ou la collectivité, ses motivations, ses besoins légitimes, son engagement, ses forces, ses faiblesses, la réalité dans laquelle elle évolue, etc.»
Il y a bel et bien respect… et respect. L’un, formel, fait de convenances, superficiel et codifié. L’autre, plus exigeant, parce que substantiel et dynamique. Le premier peut très bien s’accommoder d’une bonne dose d’hypocrisie et de mépris. Le second ne peut pas tricher, puisqu’il prend en compte la dignité humaine dans sa globalité : la personne et/ou la collectivité, ses motivations, ses besoins légitimes, son engagement, ses forces, ses faiblesses, la réalité dans laquelle elle évolue, etc. Le respect que nous revendiquons, c’est celui-là, même si, bien sûr – ne nous faites pas dire ce que nous n’avons pas dit -, nous reconnaissons que mettre des formes dans les relations sociales aide à huiler les rouages.
Le respect qu’ils exigent… et celui que nous revendiquons
Niveau 2, entre la salle des profs et les bureaux. Autre souvenir. Si l’enjeu n’en était pas important, nous pourrions le qualifier de croquignolet. En conflit ouvert sur des orientations lourdes de conséquences prises de manière autocratique par les seuls pouvoir organisateur (PO) et direction de notre établissement, avec quelques camarades, nous en sommes venus à ne plus saluer notre directeur, qui nous rend la pareille. Le président du PO nous enjoint alors, comme préalable à toute reprise de la concertation, de renouer avec les salutations respectueuses et de dire à nouveau « bonjour » à un directeur qui multiplie pourtant à notre égard médisances, calomnies et discriminations syndicales. Soit. A dater de ce rappel salutaire, chaque fois qu’il nous arrive de le croiser, nous mettons un point d’honneur à saluer notre patron d’un ostentatoire « bonjour », marque d’un respect… qu’il ne goute que modérément.
Dans cette affaire-là aussi, il sera question de perceptions opposées du respect. En l’occurrence, PO et direction veulent faire passer à toute force une réforme des 7èmes professionnelles. Historiquement, dans notre établissement, elles sont organisées en plein exercice. Désormais, elles se feront en alternance, trois jours/semaine en entreprise, deux à l’école. Une rupture problématique pour bon nombre des élèves concernés et plusieurs de leurs professeurs. Impossible cependant d’en débattre au sein de l’institution. Du côté du pouvoir décisionnel, deux approches se superposent : l’une, que nous qualifierons de managériale (pour des raisons comptables opaques et pour s’inscrire dans le sens dominant du courant néolibéral, il « faut » franchir le pas du CEFA), l’autre, plus foncièrement conservatrice (par principe, il ne revient pas à des travailleurs de l’éducation, et encore moins à des élèves, fussent-ils majeurs, de contester une décision prise par la hiérarchie[1]). De l’autre côté, il y a des enseignants et des élèves qui estiment au contraire que tout ce qui concerne leur vie quotidienne, leur formation, leur travail présent et à venir… les concerne au premier chef. Et qu’en démocratie, on doit pouvoir débattre de points de vue contradictoires sur une base dûment argumentée.
Cette « bataille du CEFA » dessine une frontière assez nette entre deux mondes. Les premiers exigent le respect de la part des élèves, mais décident ce qui sera bon pour eux : sous le prétexte pseudo-humaniste d’un petit pécule touché à la fin de chaque mois, on les soumettra, plus tôt que nécessaire, à la loi de l’entreprise, avec tout ce que ça comporte de risque d’accident, d’usure prématurée au travail, etc. Les premiers tranchent, bien au chaud dans leurs bureaux, et exigent le respect de leurs enseignants, qui devront, en première ligne, « faire avec » des élèves débarquant à l’école le jeudi matin, totalement déphasés par rapport aux cours, parfois trop épuisés pour faire quoi que ce soit de bon. Les seconds, des élèves finissant la 6ème année, disent au contraire leur attachement à la 7ème année de plein exercice pour ensuite se lancer dans le supérieur de type court. Ceux-là n’ont aucune envie de passer une année à risquer leur santé sur chantier. Mais aussi des enseignants qui appuient la revendication cohérente et légitime des élèves.
La réponse sera le mépris et le passage en force.
Oh, bien sûr, ceux d’en haut vous respectent – mieux, vous encensent – … quand vous multipliez les activités bénévoles « au service de l’école et des enfants ». Mais les mêmes vous manifesteront une très sincère désaffection dès que vous aurez eu l’outrecuidance de leur poser une question qui fâche.
Niveau 3, Bruxelles, Place Surlet de Chokier. Notre ministre, l’affable Valérie Glatigny, ne s’abaissera sans doute jamais aux outrances de son président de parti. On peut sans risque prévoir qu’elle continuera de faire montre d’un exquis savoir-vivre. Il n’en reste pas moins que sa gestion de l’Education manque de respect aux enfants et aux personnels de l’enseignement. La mascarade de son « baromètre du respect », dont il est question dans ce dossier, en est une belle illustration, « une masterclass de manipulation politique réactionnaire », pour reprendre les mots de Renaud Maes dans ces colonnes. Elle peut se donner des airs de grande défenderesse du respect dû aux enseignants, quasi-sacralisés (des mots, des postures, une vision somme toute réac’ du métier), elle n’en est pas moins en train de saper très matériellement notre boulot : remise en cause du statut qui nous protège, suppressions d’emploi en catimini, tentatives de contournement de la concertation sociale – « mise au vert du Pacte », etc. Que penser en effet du « décret Programme » qu’elle nous prépare en ce printemps ? Luc Toussaint, de la CGSP Enseignement : « C’est difficile de se sentir écouté quand la Ministre lance un groupe de travail sur les statuts tout en avançant en parallèle un décret qui modifie en profondeur les règles »[2].
« C’est difficile de se sentir écouté quand la Ministre lance un groupe de travail sur les statuts tout en avançant en parallèle un décret qui modifie en profondeur les règles ». (Luc Toussaint, CGSP Enseignement) »
Vous l’aurez compris, le respect que nous revendiquons, ce n’est pas le respect bourgeois, illusion d’égalité masquant la violence d’une élite accrochée à ses privilèges envers tout qui voudrait les menacer. Il n’est pas affaire de bons sentiments, désincarnés, au besoin hypocrites, instrumentalisés pour fluidifier un « vivre-ensemble » où ce sont toujours les mêmes qui sont du bon côté du manche et les autres qui trinquent. Non. Il est fondé sur la reconnaissance de la dignité humaine, de l’égalité, de la liberté, et il se mesure en actes concrets. Pour nous, progressistes, le respect se matérialise dans la satisfaction de besoins humains : logement, nourriture, accès à la culture. Il se matérialise dans la coopération, dans des collectifs où les ressources sont partagées, dans des adhésions raisonnées, hors de toute hiérarchie arbitraire et oppressive. Il se matérialise dans l’inclusion, l’émancipation, l’autonomie corporelle, un rapport apaisé avec la nature…
C’est dans ce sens que l’Aped revendique depuis toujours une Ecole à la fois ambitieuse et équitable pour tous les enfants.
Notre « baromètre du respect » à nous !
Nous n’avons pas attendu l’arrivée au pouvoir de la majorité MR/Engagés pour penser l’Ecole et la vouloir respectueuse. Ce que nous vous proposons ci-après, c’est en quelque sorte une grille d’évaluation du degré de respect du pouvoir politique à l’égard des élèves et des travailleurs de l’éducation. Elle est critériée, comme il se doit…
Critère 1 – Des écoles véritables lieux de vie, où il fait bon vivre
Des toilettes propres et en nombre suffisant, un réfectoire pas trop bruyant, des classes lumineuses et spacieuses, bien chauffées en hiver, bien aérées en été, des lieux de jeu et de détente avec de l’espace, des pelouses, des arbres, des fleurs, une collation le matin et l’après-midi, un bon repas à midi…
« Une école où on apprend ensemble un respect qui ait le gout du collectif : comment se doter de règles communes et les faire respecter ? Comment coopérer ? Comment s’aider mutuellement ? Comment réaliser des projets ? Comment faire valoir mes envies légitimes tout en respectant celles des autres ?
Une école ouverte après les heures de cours, le week-end, pendant les vacances. Avec du personnel qualifié pour aider et encadrer ceux qui en ont besoin pour faire leurs devoirs et étudier leurs leçons.
Une école où, justement, on apprend ensemble un respect qui ait le gout du collectif : comment se doter de règles communes et les faire respecter ? Comment coopérer ? Comment s’aider mutuellement ? Comment réaliser des projets ? Comment faire valoir mes envies légitimes tout en respectant celles des autres ?
Tout cela bien sûr avec du personnel supplémentaire : pas question d’ajouter encore à la charge de travail des enseignants en place.
Critère 2 – Tous capables, tous citoyens !
Le fonctionnement de la démocratie — ou sa conquête — exige que les citoyens aient la capacité, non seulement formelle mais réelle, de participer aux décisions. C’est ce que nous, nous mettons derrière le terme « respect ». Dans cette optique, il est nécessaire que tous disposent des connaissances permettant de comprendre le monde dans toutes ses dimensions et d’une formation intellectuelle permettant de réfléchir « avec sa propre tête » à la façon dont on pourrait l’améliorer ou le transformer. Moyennant une organisation adéquate du système scolaire et les moyens appropriés, nous avons la conviction que tous peuvent atteindre un haut niveau d’émancipation grâce à l’Ecole. De cette ambition découlent les critères suivants.
Critère 3 – Sortir les enfants pauvres de l’apartheid scolaire
Le respect, c’est proposer aux enfants des classes populaires autre chose que des écoles ghettos, d’ailleurs souvent désignées du terme méprisant d’ « écoles-poubelles ». La mixité sociale dans tous les établissements de Belgique, c’est nécessaire et c’est possible. Il existe une solution qui, tout en respectant le principe du libre choix des parents, garantirait une réelle mixité sociale et académique des écoles. L’Aped et un large collectif progressiste avancent dans cette direction : « Une place dans une bonne école pour chaque enfant ».
Critère 4 – Une formation générale et polytechnique ambitieuse pour tous les enfants
Si des mesures préalables sont mises en oeuvre — effectifs réduits en début de scolarité, école ouverte et soutien maximal pour chaque enfant, fin de la ségrégation et des écarts de niveau entre écoles —, alors il sera possible d’aboutir à un véritable « tronc commun » ambitieux, sans risque de « nivellement » par le bas et sans décourager des masses d’élèves largués avant d’arriver au terme. Car le véritable respect, il est là : refuser la « fatalité » du nivellement par le bas, d’une réduction des ambitions de l’Ecole à seulement maîtriser des « compétences de base » et à « apprendre à apprendre ». Voilà un autre indicateur : dans quelle mesure mettrons-nous fin à la sélection sociale, reléguant toujours les mêmes (avec quel mépris) dans les filières conduisant aux métiers les plus dégradants (en termes d’intégrité physique, de condition sociale et de revenus) ?
Critère 5 – Des petites classes
Passer ses journées en classe, se concentrer sur le travail, prendre le temps de faire ses devoirs et d’étudier ses leçons… tout cela nécessite un effort de la part de l’enfant. Pour obtenir cet effort, il faut prendre le temps de construire avec lui un rapport positif à l’école et aux savoirs scolaires. Cela nécessite de pouvoir l’aider et l’encourager quand les difficultés lui semblent trop grandes, ne jamais le laisser « décrocher », ne jamais abandonner, mais combiner en permanence l’exigence à la bienveillance. Cela nécessite d’abord des enseignants qui ont du temps pour chaque enfant. C’est pour cela que la capacité d’encadrement dans les premières années d’école est cruciale, particulièrement pour ceux qui ne pourront pas trouver cet encadrement et ce soutien en dehors de l’école. Nous proposons l’indicateur suivant : 15 enfants par classe dans le bien-nommé fondamental.
Critère 6 – Un encadrement de qualité
Les conditions de travail des personnels de l’éducation sont primordiales. Elles ne peuvent qu’avoir un effet important sur la qualité de la scolarité des enfants, évidemment. On voit ce que donne le contexte de pénurie qui s’installe. Pour en sortir par le haut, le respect que réclament les travailleurs de l’éducation se mesurera à l’attractivité des salaires, à l’investissement public dans la formation initiale et continuée, à la protection effective de statuts spécifiques leur permettant de se concentrer pleinement sur leurs tâches pédagogiques, à des conditions de travail et des charges horaires leur permettant notamment d’oeuvrer en équipes, etc.
Critère 7 – Le respect des travailleurs de l’éducation comme acteurs sociaux responsables
Les enseignants n’ont pas besoin qu’on les enferme dans des contrats d’objectifs ou un « New Public Management » inspiré du secteur privé. Bien formés, travaillant en équipes, sur base de programmes clairs, ils doivent se voir reconnaître le droit de travailler dans la liberté pédagogique. Leur consultation par les différents niveaux de pouvoir doit être autre chose que de la mystification. Leurs organisations représentatives, dûment élues, doivent se voir respecter comme seules interlocutrices légitimes, sans tentatives de contournement par des pseudo-enquêtes et autres manoeuvres dilatoires.
Critère 8 – Un financement suffisant et juste
Désolés pour nos éminences néolibérales, le respect de l’enseignement ne se paie pas en monnaie de singe. Nos indicateurs sont très matériels : passée depuis 1980 de 7 à 6% du PIB, avec pourtant des besoins plutôt en hausse, l’Ecole ne s’y retrouve pas. Une révision de la loi de financement s’impose, afin d’assurer un refinancement global de l’enseignement belge et afin de faire en sorte que chaque enfant ou jeune, qu’il soit Flamand, Wallon ou Bruxellois, bénéficie d’un enseignement de qualité dans les mêmes conditions.
Notes